« On parle de (bien) commun chaque fois qu’une communauté de personnes est animée par le même désir de prendre en charge une ressource (dont elle hérite ou qu’elle crée) et qu’elle s’auto-organise de manière démocratique, conviviale et responsable pour en assurer l’accès, l’usage et la pérennité dans l’intérêt général et le souci du ‘bien vivre’ ensemble ainsi que du bien vivre des générations à venir. »
Proposée par Alain Ambrosi et rappelée par Lionel Maurel, dans un texte lumineux qui analyse (au travers du prisme méthodologique élaboré par Elinor Ostrom) l’expérience « #BiblioDebout », cette définition claire et synthétique permet de se représenter la diversité des ressources (naturelles, matérielles et immatérielles) que nous pourrions appréhender comme des communs.
Pour autant le développement et/ou la préservation de ces communs (par exemple un projet citoyen d’énergie renouvelable, des jardins partagés, un tiers-lieu open-source, du mobilier urbain pour échanger/donner des livres/des objets disposés dans l’espace public, un logiciel libre, des plans open-source d’une machine agricole, des savoirs communs et partagés, un réseau d’accès associatif à Internet, etc.), impliquent que certains usagers-contributeurs y passent du temps et y engagent leur compétence, tandis que d’autres, y compris des acteurs marchands, se contentent d’utiliser les ressources communes, voire d’en tirer un profit personnel.
L’idée défendue par Michel Bauwens, de constituer à différentes échelles territoriales, des binômes « chambres des communs » (instances de type consulaire capables de faire le lien entre les contributeurs bénévoles et les utilisateurs marchands des ressources communes) / « assemblées des communs » (capables notamment d’identifier et de documenter le fonctionnement de ces communautés gestionnaires de ressources partagées), permet d’imaginer des solutions de cohabitation coopérative entre communs et économie marchande.
Une telle articulation peut-elle s’avérer pérenne ou bien ne constituer qu’une phase de transition dans la perspective d’un changement irréversible de nos relations à la propriété ?
Trois enjeux méritent d’être explorés pour répondre à cette question :
Le premier enjeu est celui de la protection des ressources communes contre les enclosures ainsi que de leurs contributeurs et contributrices contre le risque de dépossession de leur œuvre.
L’étude historique du mouvement des enclosures (qui comme le rappelle Lionel Maurel, « s’est produit en plusieurs vagues, du 12ème au 18ème siècle, démantelant progressivement les droits d’usages collectifs en distribuant des droits de propriété privée au bénéfice de certains grands propriétaires terriens »), nous permet aujourd’hui de mieux analyser les risques que font courir aux communs la privatisation, tout comme « l’étatisation », d’une ressource naturelle ou matérielle, initialement gérée de manière collective pas ses usagers.
Mais le processus de confiscation devient encore plus flagrant, dès lors qu’il s’agit d’une ressource immatérielle et « non-rivale » comme la connaissance universitaire, la création artistique ou littéraire ou encore le génome d’une plante, que des entreprises purement capitalistes privatisent au nom de la propriété intellectuelle ou industrielle.
Quant aux contributeurs/contributrices aux communs, qui investissent bénévolement du temps et du talent à les créer, les maintenir et les développer, le premier enjeu (on évoquera plus loin la question de la réciprocité) est de pallier au risque de dépossession intellectuelle de leur travail.
Ainsi une contribution libre à un commun dont les droits de partage ne seraient pas juridiquement protégés, peut à tout moment être appropriée par une personne ou un entreprise, susceptibles de revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur les produits de cette contribution.
Pour pallier à ces risques d’enclosure et de dépossession, il existe au moins deux catégories de solutions : la dissociation juridique entre la propriété et l’usage d’une part, les licences libres d’autre part.
Le droit de propriété bénéficie d’une protection particulière en droit français puisqu’il est visé dans la déclaration des droits de l’homme, qui a valeur constitutionnelle. Il apparaît donc difficile de le remettre en question, même s’agissant d’une ressource considérée comme un commun. Il existe cependant différentes façons de dissocier juridiquement la propriété de l’usage, susceptibles de protéger les usagers d’un « commun » (les commoners) du risque de détournement ou de confiscation de cette ressource par la personne morale ou physique qui en est légalement le propriétaire.
Ainsi le droit coopératif permet de distinguer clairement la coopérative – propriétaire par exemple d’un bien immobilier (coopérative d’habitants), d’une entreprise (SCOP ou SCIC), ou de matériel agricole (CUMA) – et les coopérateurs/trices, sociétaires de la coopérative et usagers de ses ressources, mais également associés démocratiquement (une personne = une voix) à la gouvernance de leur « bien commun ».
Dans un autre registre, les baux emphytéotiques permettent à un propriétaire immobilier de louer son bien à des usagers pour une longue durée (18 à 99 ans), charge à ceux-ci de l’entretenir et de le préserver tandis que « les foncières » comme Terres de Lien (ou encore les « Community Land Trust ») permettent d’acquérir des terres ou des biens immobiliers pour en assurer, sur le long terme, une gestion sociale et écologique conforme à une charte.
Le droit anglo-saxon dispose quant à lui d’un concept intéressant dont les commoners pourraient se saisir, il s’agit du « trustee » qui désigne une personne ou une structure qui se voit confier un mandat de gestion très précis pour le compte des bénéficiaires d’une ressource. La récente création à Lille d’une association baptisée LSC1 (pour « Legal Service for Commons ») en constitue une déclinaison expérimentale. Son objet est de « protéger de soutenir des communautés produisant des ressources ouvertes et partagées, appelées communs libres » et sa gouvernance est constituée d’un « collège » de personnes de confiance qui veillent à ce que les ressources produites par les « contributeurs » soient protégées et le cas échéant rémunérées.
Concernant la protection des contributeurs/trices, la création des licences libres « creative commons » qui « proposent une solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle standard de leur pays, jugés trop restrictifs », ont permis (depuis 2004 en France) aux auteurs souhaitant contribuer aux communs, de définir et de protéger juridiquement les conditions du partage et de la réutilisation de leurs productions.
Il en va de même avec les nombreuses licences « open-source » développées par le monde du logiciel libre et répertoriées par l’OSI, tandis que se pose la question de leur déclinaison pour tout ce qui concerne le « hardware » et les inventions mécaniques qui ne reposent pas directement sur un code logiciel.
Ces différents dispositifs bien qu’encore très imparfaits (cette liste n’étant certainement pas exhaustive), permettent d’ores et déjà aux commoners de concevoir des mécanismes de prévention des risques d’enclosure des communs et de confiscation du produit de leurs contributions.
Cependant les assemblées et les chambres des communs pourraient se donner comme objectif de les améliorer, en documentant les expérimentations existantes et en mobilisant des collectifs de juristes pour les rendre transférables et adaptables.
Le second enjeu est celui de la réciprocité et/ou de la rétribution des contributions
Cela peut tout d’abord paraître contradictoire de parler de rétribuer des contributions apportées à un commun et pourtant cette question nous concerne tous, dès lors que nous nous connectons à Internet ou nous utilisons notre smartphone.
En effet chaque clic effectué sur un moteur de recherche ou sur un réseau social fait de nous un « digital worker » qui contribue bénévolement à générer une gigantesque masse de données (Big Data), exploitée à des fins marchandes et confiscatoires par les plateformes qui mettent « gratuitement » ces services à notre disposition.
D’un autre côté, la majeure partie des lignes de codes écrites pour le logiciel libre, le sont par des salariés de groupes informatiques privés qui autorisent explicitement leurs employés à contribuer « bénévolement » à un commun dont le développement alimente leur modèle économique.
Mais pour les personnes qui souhaiteraient contribuer plus activement à créer, développer et préserver des ressources en communs, la nécessité de « gagner sa vie » limite fortement le temps qu’elles voudraient pouvoir y consacrer.
Ce n’est pas par hasard que les périodes de chômage (contraintes ou choisies) ou de départ à la retraite permettent à certains de s’investir dans des activités porteuses de sens et de (re)découvrir que « travailler » n’est pas nécessairement synonyme d’emploi salarié.
Si l’on admet avec Frédéric Sultan que « les transitions auxquelles nous sommes confrontés nous invitent à inventer d’autres approches que le système bipolaire État/marché, à construire de nouvelles alliances dans lesquelles les communs permettent de renouveler l’imaginaire politique pour adapter l’action publique aux enjeux du 21ème siècle » il apparaît évident qu’inventer des formes de rétribution (au moins partielles) pour les contributeurs et contributrices aux communs permettrait de « passer à l’échelle » et d’accélérer l’indispensable engagement d’un processus de transition durable.
Deux voies peuvent être envisagées pour répondre à ce besoin de rétribution, la première et la plus immédiatement opérationnelle, décline les différentes possibilités de « donner » aux contributeurs afin de rémunérer (partiellement) leur temps de travail. La seconde plus ambitieuse consisterait à organiser un système pérenne de réciprocité entre contributeurs et bénéficiaires de ressources « communes », sans pour cela d’ailleurs que ces rôles soient figés.
Plusieurs plateformes numériques permettent ainsi aux commoners de faire appel au don pour soutenir leur travail de contribution, que ça soit pour un projet particulier via une campagne de crowdfunding (très nombreuses plateformes), ou bien plus pointu, sous la forme de dons récurrents visant à établir une relation de financement « durable » comme le résume dans son blog Philippe Scoffoni.
Une plateforme comme « Liberapay » permet ainsi à un auteur ou un projet de bénéficier d’un revenu à peu près stable dans le temps. Les participants s’engagent à verser une somme donnée toutes les semaines. Il incombe en effet aux utilisateurs de la plateforme de financer son fonctionnement et les contributions peuvent s’effectuer au profit de personnes ou d’équipes. Dans ce dernier cas, ce sont les membres de l’équipe qui définissent les règles de répartition des sommes perçues.
Cependant le don peut aussi prendre la forme du mécénat classique pratiqué par une personne, une entreprise ou une fondation, ou bien encore d’une subvention accordée sans contrepartie par l’État ou une collectivité publique au titre de « l’intérêt général », ces types de contribution privées ou publiques pouvant également prendre la forme d’un apport financier ou en nature (mise à disposition d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un équipement, d’une compétence…).
Mais il en va différemment du concept de réciprocité car il s’agit ici d’imaginer un système pérenne où contributeurs et bénéficiaires de communs pourraient, dans l’idéal, « équilibrer » leurs apports.
La première piste étudiée a été celle des licences réciproques qui, comme le résume Pierre-Carl Langlais « visent à restaurer une relation de réciprocité entre le secteur commercial et le mouvement des Communs en établissant un mécanisme de réversion dès lors qu’une organisation capitalistique fait usage d’un bien commun ». Cependant cette idée se heurte encore à un certain nombre de difficultés concernant notamment le choix de l’unité de compte et l’éthique des protagonistes.
La seconde piste fait l’objet d’un très ancien débat redevenu fortement d’actualité, il s’agit du revenu universel ou Revenu de Base Inconditionnel et de ses alternatives comme le revenu contributif prôné par Bernard Stiegler ou encore la salaire à vie défendu par Bernard Friot. Dans ce cas c’est la société qui décide de rémunérer globalement et indistinctement le temps de la contribution de ses membres au bien commun par un système public de redistribution. Mais là aussi les différentes approches idéologiques qui sous-tendent ce concept (du libertarisme californien au coopérativisme proudhonien) tout comme les énormes réticences morales que soulève l’idée « d’être payé à ne rien faire » laissent augurer d’encore bien des obstacles avant qu’un tel système voit le jour.
Cependant une troisième piste mériterait sans doute d’être approfondie, celle qui consisterait à recourir au système des « chambres de compensation », un système économique ou chacun est invité à payer ses dettes avec ses créances. L’avantage principal d’une chambre de compensation, est qu’elle transforme les dettes et les créances bilatérales en dettes et en créances multilatérales. Le commoner ou l’entreprise A, qui a une créance envers le commoner ou l’entreprise B, suite à une contribution ou à une utilisation d’un commun, peut immédiatement dépenser cette créance avec un commoner ou une entreprise C.
De façon symétrique, un commoner ou une entreprise D qui a une dette avec l’entreprise E règlera sa dette en contribuant aux communs utilisés par l’entreprise F ou A.
Le système repose sur une unité de compte (une monnaie complémentaire) dont la multilatéralité va permettre d’amplifier l’activité économique et la production de communs, chacun des adhérents ayant la capacité à trouver dans le réseau de nouveaux partenaires qui sont autant de nouveaux contributeurs.
La technologie des blockchain qui connaît un développement spectaculaire, pourrait ici être mise au service du bien commun.
Et de fait, le troisième enjeu apparaît bien comme celui de la mise en place de ces binômes assemblée/chambre des communs qui permettraient d’expérimenter localement ces différentes formes de cohabitation entre communs et économie.
Constituées à l’échelle locale des « porteurs de communs » (que sont par exemple les tiers-lieux, les jardins partagés, les projets d’habitat coopératif, une foncière comme « Terre de Liens », des monnaies complémentaires, les producteurs et diffuseurs d’œuvres du domaine public, les développeurs de logiciels libres, une épicerie coopérative, un fournisseur d’accès à Internet associatif et citoyen, une régie de quartier, une conciergerie solidaire, un dispensaire social, une université populaire…), les assemblées des communs pourraient se donner comme objectif de coordonner et populariser l’accès, la défense contre les enclosures et le développement des communs sur leur territoire, en élaborant puis en faisant vivre démocratiquement une charte sociale des communs.
Susceptibles de proposer aux pouvoirs publics d’assumer la gestion citoyenne et responsable de certains communs (espaces publics, agriculture dans la ville, tiers-lieux publics, salles associatives, espaces de gratuité…), de proposer aux entreprises une relation coopérative gagnant – gagnant, grâce à la création d’une « chambre des communs » (permettant à celles-ci de participer à la rémunération des communs, en contrepartie de leur utilisation des ressources et savoirs partagés issus des communs…) elles pourraient s’imposer comme une véritable alternative au dialogue devenu stérile entre l’État et le Marché, en permettant aux citoyens de s’impliquer localement dans la gestion des ressources du vivre ensemble, sans remettre en cause directement l’utilité de des élus et des entreprises, favorisant ainsi l’amorce d’un processus de transition soutenable.
Plus spécifiquement les chambres des communs pourraient organiser les activités économiques autour des communs, en demandant aux acteurs économiques de participer à leur rémunération (en contrepartie de l’utilisation des ressources et savoirs partagés issus des communs) afin d’établir ainsi une relation coopérative gagnant – gagnant entre communs et économie.
Elles pourraient également tenter de sensibiliser l’acteur public à la réforme des marchés en privilégiant la production directe de communs ou le développement de services autour de commun (par exemple plutôt que de développer au niveau de chaque collectivité un logiciel « propriétaire » de gestion des vélos en libre service, plutôt que de le développer en logiciel propriétaire individuellement par, le développement d’un logiciel libre pourrait être mutualisé avec l’ensemble des villes du monde ayant à mettre en place un système de vélo partagé).
Elles pourraient enfin faciliter la collaboration des entreprises qui développent de l’activité économique autour des communs et assurer le dialogue avec l’Assemblée des Communs (le rapport entreprises/société).
Photo : Pesée de marchandises, amphore du Peintre de Taléidès, v. 540-530 av. J.-C., Metropolitan Museum of Art • Taléidès comme potier (signature), Peintre de Taléidès • CC BY 2.5 (Source : Wikipedia)



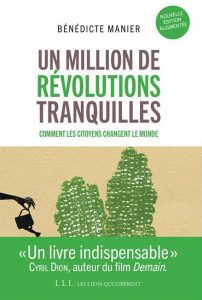 Ils sortent de la faim et de la pauvreté des centaines de milliers de personnes. Ils sauvent des entreprises. Ils construisent des habitats coopératifs, écologiques et solidaires. Ils ouvrent des cliniques gratuites, des microbanques, des épiceries sans but lucratif ou des ateliers de réparation citoyens. Ils reverdissent le désert et régénèrent les écosystèmes. Ils financent des emplois ou des fermes bio. Et partout dans le monde, ils échangent sans argent des biens, des services et des savoirs, redynamisent l’économie locale ou rendent leur village autonome grâce aux énergies renouvelables.
Ils sortent de la faim et de la pauvreté des centaines de milliers de personnes. Ils sauvent des entreprises. Ils construisent des habitats coopératifs, écologiques et solidaires. Ils ouvrent des cliniques gratuites, des microbanques, des épiceries sans but lucratif ou des ateliers de réparation citoyens. Ils reverdissent le désert et régénèrent les écosystèmes. Ils financent des emplois ou des fermes bio. Et partout dans le monde, ils échangent sans argent des biens, des services et des savoirs, redynamisent l’économie locale ou rendent leur village autonome grâce aux énergies renouvelables.
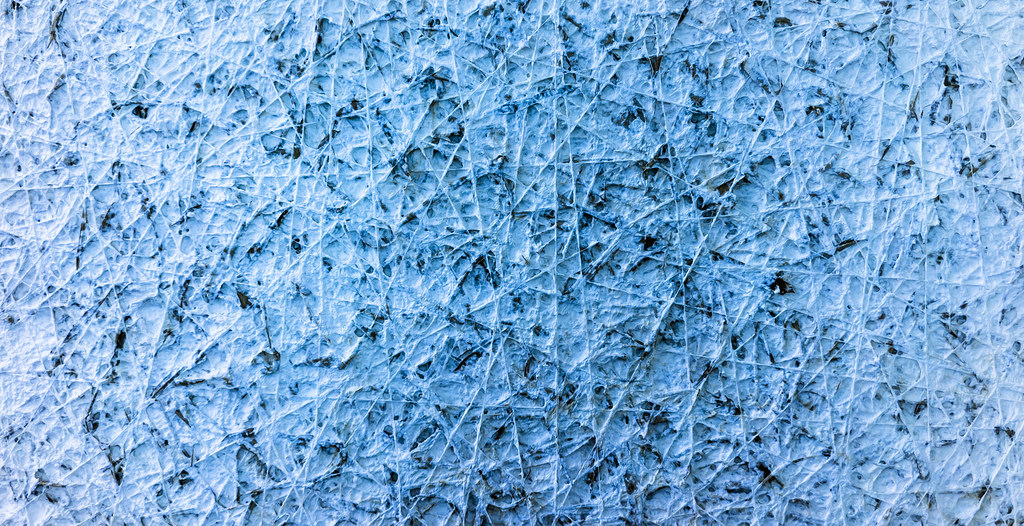
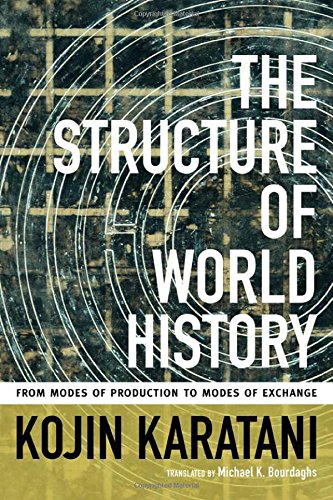
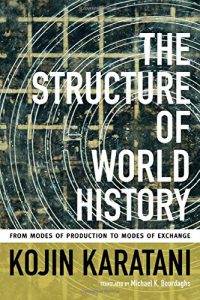 Dans ce grand travail qui participe du changement de paradigme, Kojin Karatani re-lit systématiquement la vision de l’histoire du monde de Marx, en déplaçant l’accent de la critique des modes de production à celle des modes d’échange. Karatani cherche à comprendre à la fois la triade Capital-Nation-État, le système de verrouillage qui est la forme dominante de société mondiale moderne, et les possibilités de son dépassement. Dans la structure de l’histoire du monde, il retrace les différents modes d’échange, y compris la mise en commun des ressources qui caractérise les tribus nomades, les systèmes d’échange de cadeaux développés après l’adoption de l’agriculture sédentaire, l’échange de l’obéissance contre la protection qui se pose avec l’émergence de l’état, les échanges de produits de base qui caractérisent le capitalisme, et, enfin, un futur mode d’échange basé sur le retour de l’échange de cadeaux, mais modifié pour s’adapter à l’époque contemporaine. Il fait valoir que cette dernière étape marquant le dépassement du capital, de la nation, et de l’état est mieux comprise à la lumière des écrits de Kant sur la paix éternelle. La structure de l’histoire mondiale est à bien des égards la pierre angulaire de la brillante carrière de Karatani, mais il signale aussi de nouvelles directions dans sa pensée. (
Dans ce grand travail qui participe du changement de paradigme, Kojin Karatani re-lit systématiquement la vision de l’histoire du monde de Marx, en déplaçant l’accent de la critique des modes de production à celle des modes d’échange. Karatani cherche à comprendre à la fois la triade Capital-Nation-État, le système de verrouillage qui est la forme dominante de société mondiale moderne, et les possibilités de son dépassement. Dans la structure de l’histoire du monde, il retrace les différents modes d’échange, y compris la mise en commun des ressources qui caractérise les tribus nomades, les systèmes d’échange de cadeaux développés après l’adoption de l’agriculture sédentaire, l’échange de l’obéissance contre la protection qui se pose avec l’émergence de l’état, les échanges de produits de base qui caractérisent le capitalisme, et, enfin, un futur mode d’échange basé sur le retour de l’échange de cadeaux, mais modifié pour s’adapter à l’époque contemporaine. Il fait valoir que cette dernière étape marquant le dépassement du capital, de la nation, et de l’état est mieux comprise à la lumière des écrits de Kant sur la paix éternelle. La structure de l’histoire mondiale est à bien des égards la pierre angulaire de la brillante carrière de Karatani, mais il signale aussi de nouvelles directions dans sa pensée. (